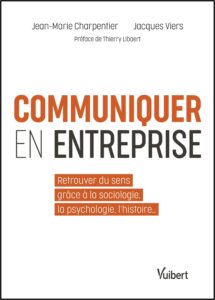Vous avez dit travail, mais de quel travail s’agit-il ?
Le 27 septembre 2022, l’Afci a attribué son prix annuel à Marie-Anne Dujarier pour son livre Troubles dans le travail Sociologie d’une catégorie de pensée paru aux PUF. Elle est sociologue, professeure de sociologie à l’Université Paris-Cité et membre du Laboratoire du changement social et politique. Dans ce passionnant livre de recherche, à la fois savant et très concret, elle revient sur la polysémie du mot travail et analyse les déformations et désarticulations que connaît le travail aujourd’hui. Nous reprenons quelques extraits de l’entretien que nous avons eu avec elle lors de la remise du prix.
Propos recueillis par Ingrid Maillard et Jean-Marie Charpentier
 …Vous distinguez trois grandes significations du mot travail. Il y a d’abord l’activité, autrement dit l’effort, la peine que l’on se donne pour faire quelque chose. Il y a ensuite l’ouvrage, c’est-à-dire le produit, le résultat du travail. Il y a enfin l’occupation, qui permet la subsistance – ce que l’on finira par appeler l’emploi.
…Vous distinguez trois grandes significations du mot travail. Il y a d’abord l’activité, autrement dit l’effort, la peine que l’on se donne pour faire quelque chose. Il y a ensuite l’ouvrage, c’est-à-dire le produit, le résultat du travail. Il y a enfin l’occupation, qui permet la subsistance – ce que l’on finira par appeler l’emploi.
Comment ces différents sens se forment-ils dans le temps ? Pouvez-vous nous donner quelques points de repère ?
Marie-Anne Dujarier : Le mot travail apparaît au XIe siècle. Il évoque l’accouchement, la peine que l’on se donne pour faire quelque chose – pas ce que l’on fait, mais la peine invisible que cela demande. Ensuite, les ergonomes appelleront cela l’activité, le fait que lorsqu’on fait quelque chose, il faut y mettre du sien – de l’intelligence, de l’habileté – pour que cela fonctionne. Plus tard, le sens de gagne- pain se collera progressivement au mot emploi.
Un autre sens est l’ouvrage, la chose faite ou à faire, la tâche. On peut ainsi se répartir le travail, ou parler d’un beau travail.
Aujourd’hui, le mot travail compte 88 synonymes au moins, autant dire qu’on a affaire à un couteau suisse ! On peut lui faire dire ce que l’on veut, c’est formidable ! Mais on retrouve quand même, historiquement, ces trois grandes significations. Entre les années 1950 et 1980, elles étaient accolées. Quand on employait le mot travail, après-guerre, on s’entendait pour dire que c’était une activité qui demande de la peine et qui produit des choses utiles (la notion d’utilité apparaît à partir du 18e siècle) à notre subsistance dans le cadre d’un emploi dont on peut vivre. En gros, l’ouvrier de chez Renault travaille : il fait quelque chose de dur, qui produit des choses utiles – des voitures – dans le cadre d’un emploi dont il peut à peu près faire un gagne- pain.
Puis, dans les années 1970, des féministes ont commencé à considérer que lorsqu’on fait des enfants, on les élève, on les emmène chez le médecin, on fait les courses, on fait le repas trois fois par jour etc., on travaille aussi, même si on n’est pas dans l’emploi. Ce premier questionnement invitait à réfléchir davantage à la catégorie de pensée travail telle qu’on l’avait construite. Les féministes ont ainsi ouvert une brèche, qui a été empruntée par de nombreux sociologues. Tout comme je parle de travail du consommateur – c’est une proposition politique, parce que le consommateur n’est pas employé au sens où il n’a pas un contrat de travail –, d’autres parlent de travail parental, de travail domestique, de travail militant… On parle même de travail bénévole. D’autres encore parlent de travail animal. Il paraît que les robots nous piquent notre travail : sans doute, donc, travaillent-ils eux-mêmes ?
De multiples emplois du mot travail sont portés par les sociologues et, plus largement aussi, par des groupes militants ou critiques, qui pointent le fait que, dans notre société, des vivants – pas seulement les humains – se donnent la peine de faire des choses productives, utiles, hors emploi. Or , il existe un hiatus entre les usages sociaux très larges du travail et les usages institutionnels, c’est-à-dire la réduction du mot travail à la simple catégorie d’emploi.

Vous êtes sociologue. Mais dans votre livre, il n’y a pas que la sociologie. Vous convoquez aussi la philosophie, l’histoire, l’économie. Est-ce à dire que la sociologie de la catégorie de pensée « travail » est nécessairement pluridisciplinaire ?
M-AD : Si le mot travail apparaît dans le langage courant à partir du XIe siècle, il apparaît dans les sciences pluridisciplinaires à partir du moment où elles se mettent à exister, ce qui est assez récent – au 18e et au 19e siècle. Toutes les sciences naissantes placent le mot travail au cœur de leurs théories. Les sciences physiques parlent de travail mécanique, un concept fondamental en physique. L’économie fait de même, avec Adam Smith et les autres, qui opposent le travail au capital et en font un concept central – pas du tout avec le même sens qu’en physique. Je vais vite, mais la psychanalyse aussi : Freud parle de travail de deuil, de travail de rêve et de travail de la cure pour parler de tout autre chose qu’est le processus intrapsychique. Les sociologues, les ergonomes…
Bref, toutes les sciences. Même la philosophie : à la même époque, Hegel se met à parler de travail alors que, jusque-là, la philosophie ne mobilisait pas ce terme. Toutes les sciences, toutes les disciplines se mettent à prendre ce mot et à en faire un concept. On quitte la catégorie de pensée ordinaire pour des concepts, avec des définitions très variables selon les disciplines. En plus, au sein d’une discipline, nous ne sommes pas tous d’accord ! Même en sociologie du travail, on ne s’entend pas ! En philosophie, c’est pire !
Il arrive de trouver plusieurs significations du travail chez un même auteur – cela a été le cauchemar d’Engels quand il traduisait Marx, lequel parle du travail tantôt comme ce qu’est la vie, avec une définition très anthropologique (travailler, c’est transformer la nature en se transformant soi-même), tantôt pour signifier le salariat (en considérant qu’il faut le supprimer). De nombreux malentendus ont aisément pu se forger, des auteurs – Marx, Freud, Nietzsche – ayant donné plusieurs significations au même mot dans leur propre œuvre, au risque de malentendus scientifiques mais aussi politiques et ordinaires.
Vous avez rappelé les trois dimensions du travail. Aujourd’hui, elles apparaissent mélangées. Les frontières sont brouillées. Où est le travail ? On a l’impression qu’il est partout, qu’il ne s’arrête jamais et qu’en même temps, il a presque disparu. Sauriez- vous nous dire à quoi tient ce « trouble » que vous évoquez et que vous illustrez très concrètement dans l’ouvrage ?
M-AD : Les principaux troubles que j’ai pu voir sont des pratiques sociales très concrètes. Il existe un continent entier d’activités qui demandent de la peine, qui produisent des choses utiles et peut-être même absolument vitales, mais qui ne sont pas dans l’emploi.
Vous aurez reconnu les tâches ménagères, les tâches parentales, le bénévolat, mais aussi ce qu’on pourrait appeler le travail animal – tout l’effort que produisent les animaux pour produire du cuir, des œufs, de la viande, pour tirer des charrettes, être chiens d’aveugles, transporter des armes, etc. Cela interroge ! Si le travail n’est que l’emploi, on devient complètement aveugle à une énorme production très utile dans la société. Il y aussi le travail écologique, c’est-à-dire la peine que nous nous donnons pour tenter de rendre cette terre habitable et qui est rarement réalisé dans le cadre de l’emploi.
À l’inverse, il existe des emplois dans lesquels on entend des salariés ou des fonctionnaires dire « quand je fais ça, ce n’est pas du travail ». « Quand je suis infirmière et que je suis contrainte de maltraiter des personnes âgées parce que je suis toute seule pour 25 la nuit, ce n’est pas du boulot » : quand elle dit ça, est-ce qu’il faut la croire ou pas ? Pour elle, subjectivement, ce n’est pas du travail. Certes, elle est rémunérée. Elle est professionnelle, donc institutionnellement elle travaille. Mais elle a le sentiment de ne pas produire quelque chose d’utile. Elle dit que ce n’est pas du travail. Ce trouble, on l’entend beaucoup dans le contexte de l’anthropocène dans lequel nous sommes. Lorsque des salariés – cadres, ouvriers, techniciens, employés… – ont le sentiment que, dans le cadre de leur emploi, ils ou elles font des choses complètement inutiles (cf. les bullshit jobs) ou carrément nocives, cela signifie qu’ils produisent à détruire. C’est assez vertigineux ! Cela vient troubler la notion de travail, parce que si l’on se donne la peine de faire des choses qui réduisent notre possibilité de subsistance sur terre…
Certaines personnes font des choses très utiles en dehors de l’emploi et ne sont pas considérées comme des travailleurs, pendant que d’autres qui le sont ont l’impression de ne pas travailler. Il faut aussi citer les nouveaux modèles productifs. Je pense au crowdsourcing. Quand on poste des photos sur un réseau social, quand on détaille son CV sur un autre site ou quand on fait des like au sujet du dernier appartement qu’on a loué, on n’a pas le sentiment de travailler. Pourtant, les firmes font des profits colossaux à partir de cette activité, qui parfois demande un peu d’effort. On voit bien que le mot travail est troublé : on ne sait plus s’il y a travail ou pas.
Il y a aussi ce qu’on appelle le bio-capitalisme : des entreprises capitalistiques font du profit à partir de l’utilisation des capacités du vivant, notamment les capacités reproductives.
Travaillez-vous quand vous donnez un rein, du sperme ou un ovule, ou quand vous les vendez ? Travaillez-vous quand vous portez un enfant pour autrui ? Travaillez-vous quand vous acceptez de faire des essais cliniques rémunérés ? Tout cela est très troublé…On est très loin du travail au sens d’horaires et de fiche de poste. Ce sont vos cellules et vos capacités reproductives qui sont mises à l’épreuve et au travail. Faut-il faire un contrat de travail avec vos cellules ? Le bio-capitalisme vient exploser les concepts de travail, à la fois du point de vue scientifique hérités de Marx et d’autres, et nos usages ordinaires du mot travail…
Il y a aussi la guérilla dans le salariat. Quand on doit changer d’uniforme parce qu’on a une activité très salissante ou très dangereuse et que changer d’uniforme prend dix minutes et parfois vingt, quand on doit se doucher parce qu’on travaille dans une centrale nucléaire, est-ce du temps de travail ? Doit-on rémunérer la question que l’on pose à un collègue, « comment tu fais dans ces cas-là ? », question tellement importante pour arriver à travailler ? Avec les 35 heures, tout cela a été plutôt remisé dans le hors travail. Mais vous savez la guérilla qu’il peut y avoir entre les employeurs, qui ont intérêt à ne pas considérer cela comme du temps de travail, et les employés qui peuvent considérer que c’en est…